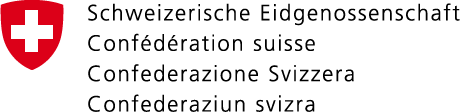Les conditions de vie de la population expriment la marge de manœuvre et les perspectives de vie dont disposent les individus et reflètent les domaines d’intervention des politiques sociales. Les conditions de vie comprennent des aspects matériels (par ex. le revenu ou le logement) et immatériels (par ex. la formation ou la santé).
Les ressources financières influencent les conditions et le niveau de vie, le niveau de consommation des biens et des services. Elles peuvent être à l’origine d’inégalités au niveau des ressources matérielles (par ex. logement, biens de consommation matériels) et immatérielles (par ex. formation, santé).
En 2020, le revenu disponible équivalent médian s’élève à 4048 francs par mois, ce qui signifie que la moitié de la population domiciliée en Suisse a un revenu supérieur, l’autre moitié un revenu inférieur à ce montant. Ce revenu a augmenté de 16% entre 2000 et 2014. Après une hausse nette de 2008 à 2013, le revenu disponible équivalent médian stagne de 2015 à 2020.
Durant les années 2015 à 2017, le revenu disponible des personnes vivant seules atteignait 4529 francs pour les moins de 65 ans et 3339 francs pour les 65 ans et plus. Chez les couples jusqu'à 64 ans sans enfants, il était de 8596 francs et, parmi les ménages monoparentaux, ce revenu était de 5703 francs, contre 9346 chez les couples avec enfants.
Les compétences et les qualifications acquises par la formation permettent de s’adapter à la société et à une économie en constante évolution.
En 2022, 13,9% de la population résidante permanente âgée de 25 à 64 ans n’a pas de formation terminée, 41,4% ont achevé une formation du degré secondaire II (école de maturité, école de culture générale ou formation professionnelle initiale) et 45,0% ont un diplôme du degré tertiaire en poche (formation professionnelle supérieure et hautes écoles).
En 2021, un tiers de la population a rencontré des obstacles pour se former. 19,2% ont participé à des activités de formation mais auraient souhaité se former davantage et 12,8% des adultes, pourtant désireux de se former, n’ont pris part à aucune activité de formation. Les deux tiers restants sont satisfaits de leur situation en matière de formation, ils se sont formés comme ils le souhaitaient (33,6%) ou n’ont manifesté aucune intention de se former (34,3%). |
Idéalement, le travail permet de subvenir financièrement à ses besoins, de développer des compétences et de s’épanouir professionnellement et socialement. Lorsque les conditions de travail sont optimales, les personnes peuvent avoir des projets sur le long terme, avoir accès à une bonne protection sociale et organiser leur quotidien au mieux. A l’inverse, lorsque le travail rime avec conditions de travail non désirées, le quotidien peut devenir synonyme de précarité.
La part des personnes actives occupées travaillant à temps partiel (taux d’occupation inférieur à 90%) est passée de 27,4% en 1996 à 37,0% en 2022. Chez les hommes, cette part ne s’élève qu’à 18,7% (contre 8,3% en 1996) alors que chez les femmes elle correspond à 57,9% (contre 52,2% en 1996).
En 2022, 7,7% des personnes actives occupées ont plus d’un emploi. Cette part a sensiblement progressé depuis 1996 (4,8%). Ceci est nettement plus courant chez les femmes (10,0%) que chez les hommes (5,7%). |
La santé détermine en grande partie l’accès au marché du travail et la participation à la vie sociale. Les inégalités et les désavantages sociaux se cumulent au cours du parcours de vie et ont des répercussions sur l’état de santé et sur les comportements en matière de santé comme le recours ou le non-recours à des prestations du système de santé.
Dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes, la manière d’apprécier son état de santé général varie nettement selon le niveau de formation. Les personnes qui n’ont accompli que la scolarité obligatoire qualifient beaucoup moins souvent leur état de santé de bon ou de très bon que celles qui ont une formation supérieure (65,3% contre 86,6%).
Selon l’Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) de 2021, 1,6 million de personnes de 16 ans et plus vivant à domicile déclarent avoir un problème de santé durable et être limitées (fortement ou pas fortement) dans les activités de la vie normale. Ces personnes sont ainsi considérées comme ayant un handicap au sens de la loi sur l’égalité. Parmi elles, 340 000 font état de limitations fortes (handicap sévère). A ces chiffres issus de l’enquête SILC s’ajoutent les enfants de moins de 16 ans et les personnes vivant dans des homes ou autres ménages collectifs. La part de personnes handicapées augmente avec l’âge : seuls 11% des jeunes de 16 à 24 ans ont un handicap, contre 39% des personnes de 85 ans et plus. Environ un tiers des personnes handicapées ont plus de 65 ans. Les femmes sont légèrement plus souvent touchées par le handicap (25% d’entre-elles) que les hommes (19%).
Les possibilités de concilier vies professionnelle et familiale sont à la croisée des décisions que font les individus en termes de choix d’enfant, de vie familiale, de répartition des rôles au sein de la famille, de partage des activités rémunérées et non rémunérées ou encore de taux d’occupation.
En 2022, dans les ménages formés d’un couple avec enfants dont les deux partenaires ont entre 25 et 54 ans, le modèle le plus fréquent est celui du père travaillant à plein temps et de la mère à temps partiel. Les familles dans lesquelles les deux parents travaillent à temps partiel sont rares. Ce modèle est cependant plus de deux fois plus fréquent lorsque le plus jeune enfant du ménage a moins de 4 ans (11%) que lorsqu’il a entre 13 et 24 ans (5%). |
Avoir un toit et se sentir chez soi représente un élément central de la couverture des besoins vitaux. Une qualité de vie acceptable dépend en bonne partie de la possibilité de disposer d'un logement assez grand, de qualité satisfaisante et à un prix abordable.
Presque 12% des personnes de moins de 65 ans vivant seules et environ 10% de celles vivant dans des ménages monoparentaux, des personnes au chômage, de celles à faibles revenus et des étrangers sont plutôt insatisfaites de leurs conditions de logement (valeurs allant de 0 à 5 sur l’échelle de mesure), alors que dans l’ensemble de la population les insatisfaits sont 5,6%. Les personnes sans formation postobligatoire et les locataires sont également plus souvent insatisfaits de leur logement que la moyenne.
Les liens sociaux permettent de faire face aux événements critiques de l’existence. Ils favorisent l’épanouissement personnel et les besoins de reconnaissance de chacun et contribuent à améliorer la santé physique et psychique.
Au sein de la population résidante, 95,8% des personnes disent avoir de la famille, des amis ou des voisins à qui demander de l’aide morale, matérielle ou financière en cas de problème, tandis que les autres n’ont personne vers qui se tourner. Les groupes de population auxquels manquent ces soutiens sont principalement les bas revenus, les personnes de nationalité étrangère, les personnes au chômage et celles sans formation post-obligatoire.
Outre les conditions de vie apparentes, objectives, le bien-être subjectif revêt aussi une grande importance. Il s’agit ici de comprendre le point de vue des individus sur leur propre existence.
La population âgée de 16 ans et plus est très satisfaite de la vie qu’elle mène, avec une valeur moyenne de 7,9 sur une échelle allant de 0 («pas du tout satisfait») à 10 («tout à fait satisfait»). Toutefois, 9,9% des personnes indiquent une satisfaction faible ou plutôt faible (valeurs allant de 0 à 5) et c’est chez les personnes au chômage, celles de moins de 65 ans vivant seules et les bas revenus que leur proportion est particulièrement élevée. La part de personnes peu satisfaites de leur vie est aussi comparativement élevée parmi les personnes sans formation postobligatoire.
Informations supplémentaires
Thèmes apparentés
Travail et rémunération
Education et science
Etat de santé
Situation économique et sociale de la population
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Aide socialeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 461 44 44