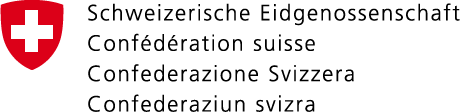Différents indicateurs en lien avec la sortie du marché du travail sont développés dans les pages qui suivent. Ces indicateurs sont tous tirés de l’enquête suisse sur la population active (ESPA) et suivent une approche «marché du travail» à savoir qu’ils se basent principalement sur le statut sur le marché du travail et non sur des aspects de prestations de la prévoyance vieillesse.
Les indicateurs sont :